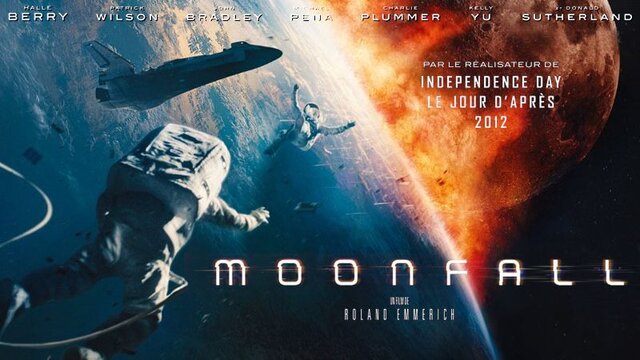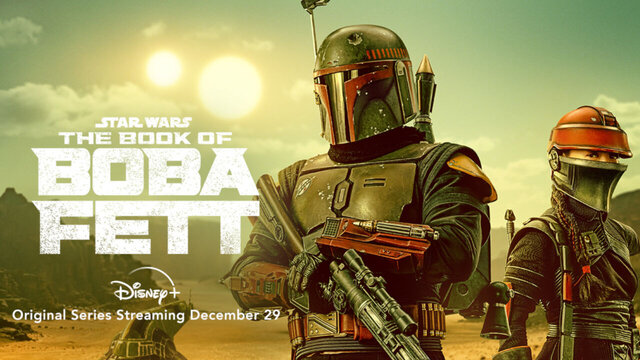LE PARRAIN (1972) – Critique
Fiche technique :
- Date de sortie : 18 octobre 1972 et date de reprise le 23 février 2022
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Avec : Marlon Brando , Al Pacino , James Caan
- Genre : Policier, Drame
- Durée : 2h55
Notre avis sur LE PARRAIN
Avant-Propos :
Il est difficile de faire une critique sur un film tel que LE PARRAIN. Ces lignes tenteront humblement de poser un avis sur cette œuvre intemporelle.
Un peu de contexte :
Aujourd’hui c’est incontestable, LE PARRAIN est une Œuvre culte et Francis Ford Coppola un réalisateur phare du XXeme siécle. Pourtant en se replaçant dans le contexte de l’époque, cette adaptation du livre de Mario Puzo ne fut pas si simple et la production du film fut compliquée.
C’est avant tout un film fait avec des seconds choix, Coppola par exemple n’eut le poste de réalisateur qu’en soumettant son idée, particulièrement pertinente, de faire un film sur la mafia mais surtout un film sur l’histoire américaine et celle du capitalisme. Mais surtout le génie de Coppola fut de raconter la spirale qui attire un homme de bien dans la folie destructrice et la solitude (parfaitement illustrée dans la trilogie notamment avec le nouveau montage du PARRAIN 3).
C’est aussi l’histoire d’un bras de fer entre le studio Paramount et le réalisateur – qui est passé proche de la sortie plus d’une fois-. Regarder LE PARRAIN c’est comprendre comment un réalisateur peut imposer sa marque et délivrer une œuvre unique que personne d’autre n’aurait pu réaliser.
Ce n’est plus un secret aujourd’hui mais il y a eu aussi de nombreuses pressions sur le film, notamment mafieuse, mais aussi de ligue de défense. Pourtant des accords furent trouvés et la production accoucha d’une œuvre majeure avec un Marlon Brando au sommet de son art (alors que lui non plus n’était pas le premier choix) et un Al Pacino qui creva l’écran (second choix aussi).
Coppola imposa sa vision et le cinéma fut changé à jamais.
Pourquoi ce film est culte :
Il y a tant de raison qui font de cette œuvre un film majeur notamment sa fin ou le passage en Sicile mais j’en retiendrais surtout un : le mariage du début.
Le mariage de Connie, la fille du parrain, est une leçon de cinéma. Cette séquence est longue mais jamais ennuyeuse. La réalisation nous montre à la fois parfaitement cette ambiance de fête, la richesse déployée mais aussi – et surtout – les traditions mafieuses avec les fameuses demandes au Parrain donnant ensuite un système de dette à ceux qui font appel à la famille Corleone. Tout est utile pour l’intrigue principale – contexte, personnalité des protagonistes, sous intrigues, contexte historique, règles mafieuses. C’est simple, à la fin du mariage, nous somme comme intégrés dans le quotidien de la famille sans nous en être rendu compte et on a l’impression de connaitre les personnages depuis des années. Pas une seconde n’est à jeter, chaque moment est savoureux.
Un des possibles sens du film :
Contrairement à ce qu’on peut penser, ce film ne fait pas l’apologie de la mafia, son sens est tout autre. LE PARRAIN montre la naissance d’un Chef avec la montée en puissance du personnage joué par Al Pacino mais aussi le déclin de tous ses principes et au final de son humanité. Il est le chef mais il n’est plus libre. Il vient de renaitre et de mourir à la fois.
Conclusion :
Ce film est une œuvre majeure du 7eme art, il est intemporel, fort et puissant. Francis Ford Coppola, envers et contre tous, nous délivre un long métrage parfait. Nous ne pouvons que le remercier et le détester à la fois car après avoir vu ce film, beaucoup d’autres œuvres vous paraitront fades
Un pilier de l’histoire du cinéma !
Critique de Grégory C.